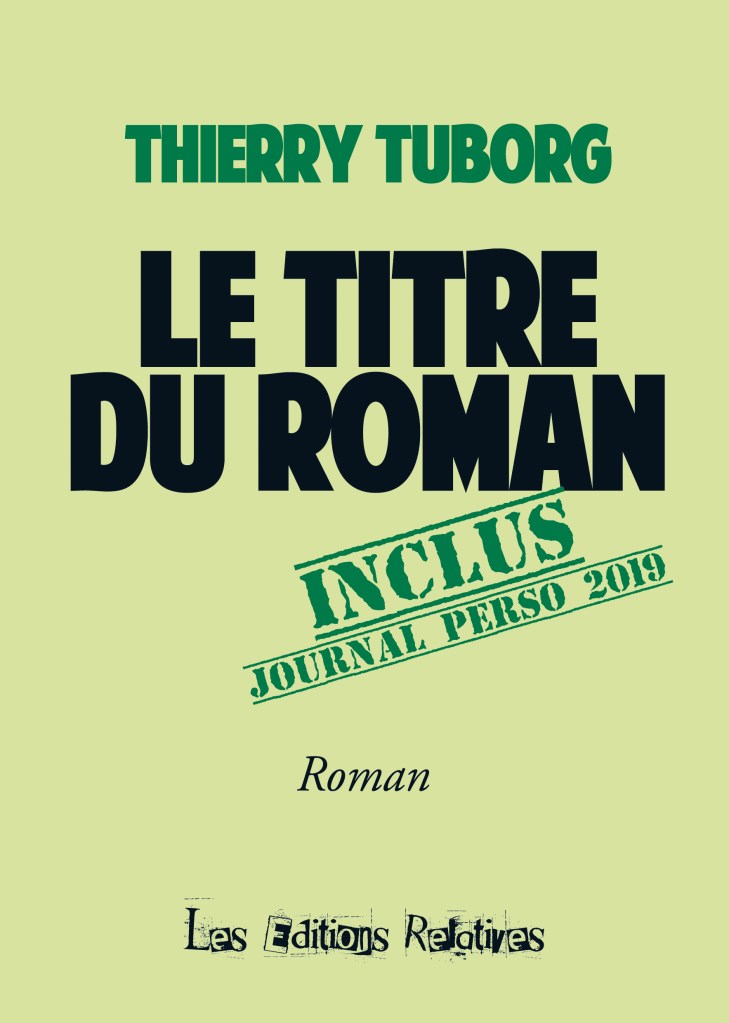
Tout le monde s’interroge depuis de longues années : Qu’a bien pu fabriquer Thierry Tuborg entre 1982, année de la dissolution du groupe bordelais Stalag dans lequel il chantait, et 1994, lorsqu’il s’est enfin posé à Montpellier pour publier ses premiers récits aux éditions Le Cercle Séborrhéique ? Ce sont en partie les réponses à cette question lancinante qui composent le présent livre, à travers de nombreuses anecdotes et révélations. Ce roman est aussi celui d’un auteur en quête frénétique du titre de son prochain récit, qu’il a parsemé de fragments de Journal Perso inédits correspondant à l’année d’écriture, comme une mise en abyme, un making of. Où l’on retrouve un homme métamorphosé. Lui à qui les lecteurs avaient maintes fois reproché le peu de profondeur qu’il accordait à ses personnages féminins, le voilà plongé dans le texte le plus romantique qu’il ait jamais publié, entre rédemption et résilience.
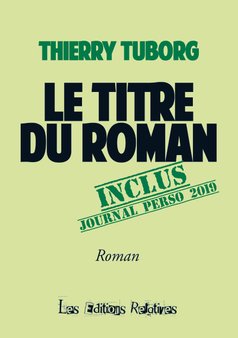
Thierry Tuborg – Le Titre du roman
Les Editions Relatives – 2020 – ISBN : 978-2-9572024-0-9 213 pages – 18 € – Livraison gratuite PAYEZ AVEC PAYPAL CI-DESSOUS ou rendez-vous en page contact pour payer par chèque
18,00 €
EXTRAIT :
Dimanche 31 mars 2019
Adoncques moi qui ne voyage jamais jamais jamais (je ne me rappelais même plus la dernière fois que j’avais pris le train. Dix ans ? Quinze ?), j’ai effectué le périple Montpellier-Bordeaux en train pour cette soirée autour de mes bouquins que Sylvie m’avait préparée au Café Culturel de L’Estran (Saint-Médard-en-Jalles, dans le Bordeaux Métropole).
Mes appréhensions étaient multiples. Innombrables. Endurer 270 minutes de train. Les retrouvailles à la gare avec Sylvie, que je n’ai pas revue depuis quarante années. Même si nous correspondons énormément depuis neuf bons mois, il s’agissait des premiers échanges de regard et du premier bisou. Je reviendrai sur ce dernier point plus tard. L’appréhension, également, de devoir m’exprimer en public dans la soirée. J’ai bien dû indiquer mille fois à Sylvie que j’étais naze à l’oral, que moi, c’était l’écrit. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai le téléphone en horreur.
Bref.
Le train ? Ce n’est pas si terrible, encore qu’au milieu du trajet j’ai tout de même griffonné nerveusement sur mon petit carnet : « La promiscuité m’a de tout temps cassé les couilles. »
Sylvie déboule tout sourire devant la gare Saint-Jean pour m’accueillir. Plus aucune appréhension. Direct, le courant passe. De quoi avais-je donc si peur, franchement ? C’est ce tempérament d’ours que j’ai acquis au fil des années.
Et je reviens au bisou. Nous nous trouvons à Bordeaux. Ici, ce sont deux bises, pas trois comme à Montpellier. Et j’adore les deux bises. À Montpellier, nous devrions dénombrer le temps qu’on aura perdu durant toute notre existence à faire cette troisième bise qui ne sert, tu le reconnaîtras, à rien.
Nous attrapons l’ami Patrick Scarzello au passage et filons sur Saint-Médard-en-Jalles, jusqu’au Café Culturel de l’Estran où nous attendait Patrice, qui chapeaute la structure. Un ami d’enfance. Nous avons beaucoup bavardé en fin de soirée. De choses que je ne puis relater.
Mais l’interview va débuter. L’on me dirige déjà sur la scène. Je souris, fais un peu mon petit malin, mais en réalité je n’en mène pas bien large, n’ayant jamais de ma vie été invité à m’exprimer sur mes propres bouquins devant un public. Mais je suis tout de même tranquillisé par le fait que c’est Sylvie qui m’interroge. Et je sais qu’elle est tout comme moi dans ses petits souliers, c’est aussi une première pour elle.
Et je trouve les mots. Et elle trouve les bonnes questions. Et elle lit des passages de Ne plus écrire. Il existe d’ailleurs une série de très belles photos réalisées par un membre de l’Estran, Julien, qui reflète précisément cette décontraction qui s’est miraculeusement installée entre Sylvie, le public et moi. Tout à fait inattendu. Tout à fait inespéré. Enfin si, tellement souhaité. Alors tout change chez moi. Je me sens comme un homme qui s’est enfin hissé hors d’un grand trou obscur. Oui, comme je l’ai écrit dernièrement à Judith, une amie cinéaste : j’étais enfin capable de donner une bonne représentation vivante de moi-même.
C’est à l’issue de l’interview, alors que je signe des livres, que pénètre dans la place Beber ! Le bassiste de Stalag, que je n’ai pas revu depuis quatorze ans ! Nous nous embrassons et il dit : « C’est bien la première fois qu’on entend du Stalag au cours d’une soirée littéraire ! », et c’est vrai, j’avais apporté une clé USB avec les chansons du groupe.
Le lendemain, je demande à Sylvie de m’emmener voir l’école de mon enfance. Celle que j’évoque dans mon avant-dernier livre, Les Fantômes du paradis :
Moi qui ai de si bonnes relations avec mon instituteur.
Ce brave homme me cite souvent en exemple pour mes rédactions et mes textes libres que nous devons lire devant la classe tous les lundis matin. J’apprendrai par la suite qu’il aura longtemps conservé mes écrits d’écolier.
Une vingtaine d’années plus tard, j’adresserai d’ailleurs une disquette contenant l’un de mes premiers manuscrits véritablement aboutis à M. Haran, dont je devrai rechercher la nouvelle adresse sur Minitel. Cette idée me traversera l’esprit, me souvenant tout à coup que si un homme un seul m’a un jour encouragé, directement ou indirectement, à écrire, c’est bien mon instituteur[1].
L’école élémentaire de La Forêt. Elle n’a pas changé. Il y a juste la grille qui séparait les garçons des filles dans la grande cour de récréation qui a disparu avec la mixité d’aujourd’hui. Nous prenons des photos. L’émotion me gagne. La nostalgie camarade. Je tente de retrouver les Trois Chênes, qui n’est autre que le décor de la toute première séquence du bouquin, l’intro, mais entretemps ils ont construit un peu partout dans ce qui n’était alors que des champs en friche et je ne parviens pas à situer l’endroit.
À partir de ce fameux jour, nous avons vu, Sylvie et moi, notre relation progresser en un éclair. J’ai baissé la garde et me suis rangé à mes sentiments. Je m’en remets à eux.
Je me rappelle une conversation que j’avais eue avec un moniteur de ski de fond du village de vacances d’hiver qui m’employait dans les années 90, au cœur du Haut-Jura. C’était un sportif de haut niveau âgé d’une trentaine d’années qui ne comptait plus les compétitions dans lesquelles il avait brillé. « Quand j’étais plus jeune, je skiais dans l’inconscience, et j’étais un champion, je gagnais tout le temps. Aujourd’hui, si je prends le risque de descendre par cette piste plutôt que cette autre, il y a des chances que je gagne cinq secondes d’avance, mais il y a aussi des chances que je me plante sérieusement, peut-être même que j’y laisse ma peau. À mesure que je prends de l’âge, j’anticipe tout, je tente de ne rien laisser au hasard, je réfléchis trop, de sorte que je suis bien moins performant à présent. »
Que l’on ne vienne pas me dire qu’on ne voit pas bien le rapport entre cette anecdote et ce qui la précède.
[1] Du même auteur, Les Fantômes du paradis, Les Éditions Relatives, 2017.